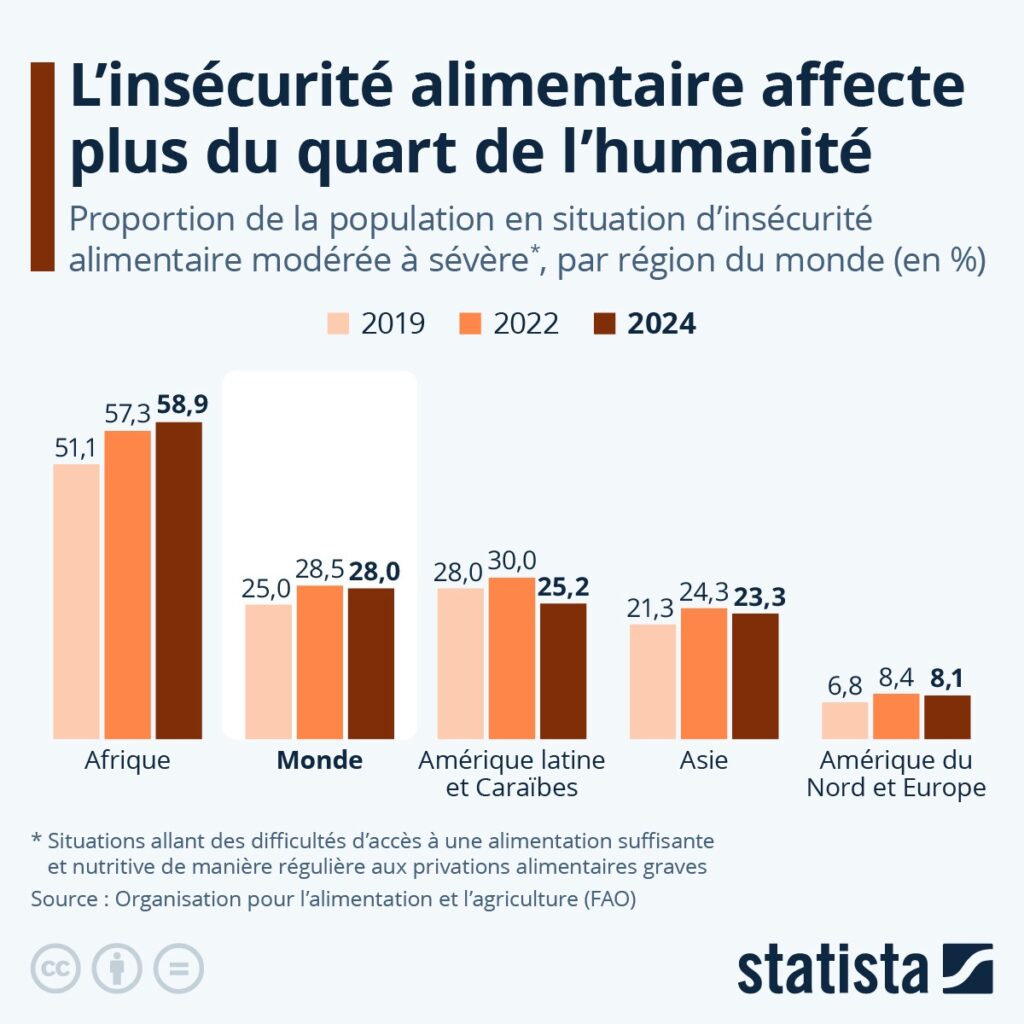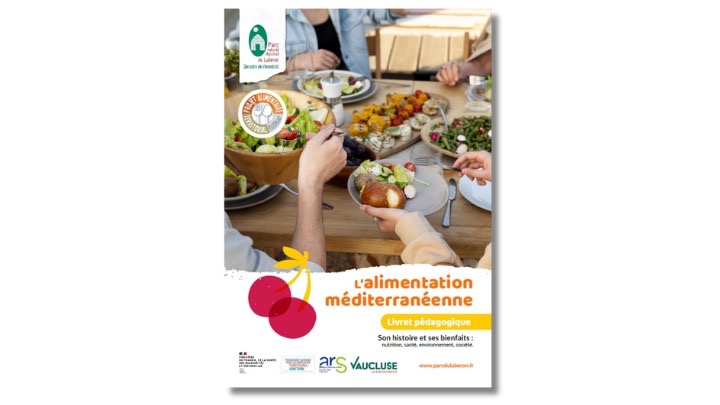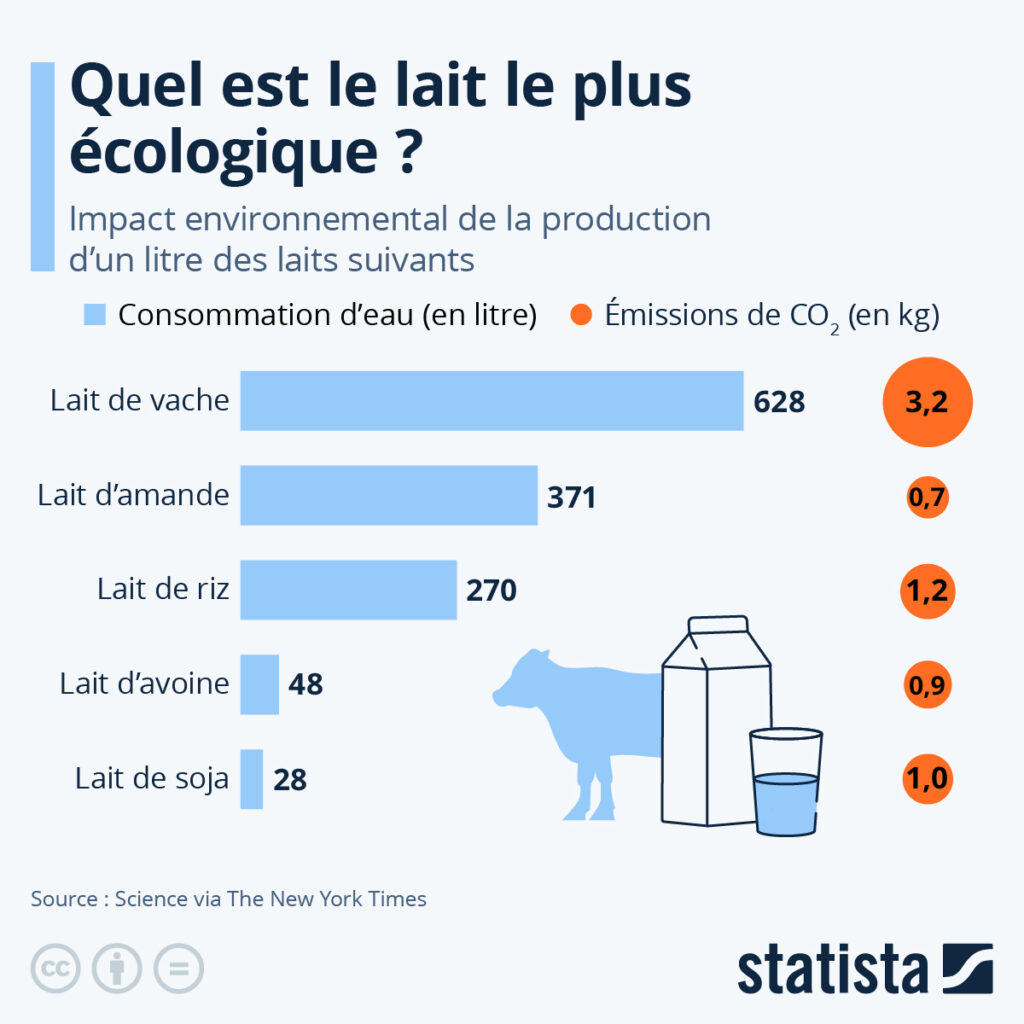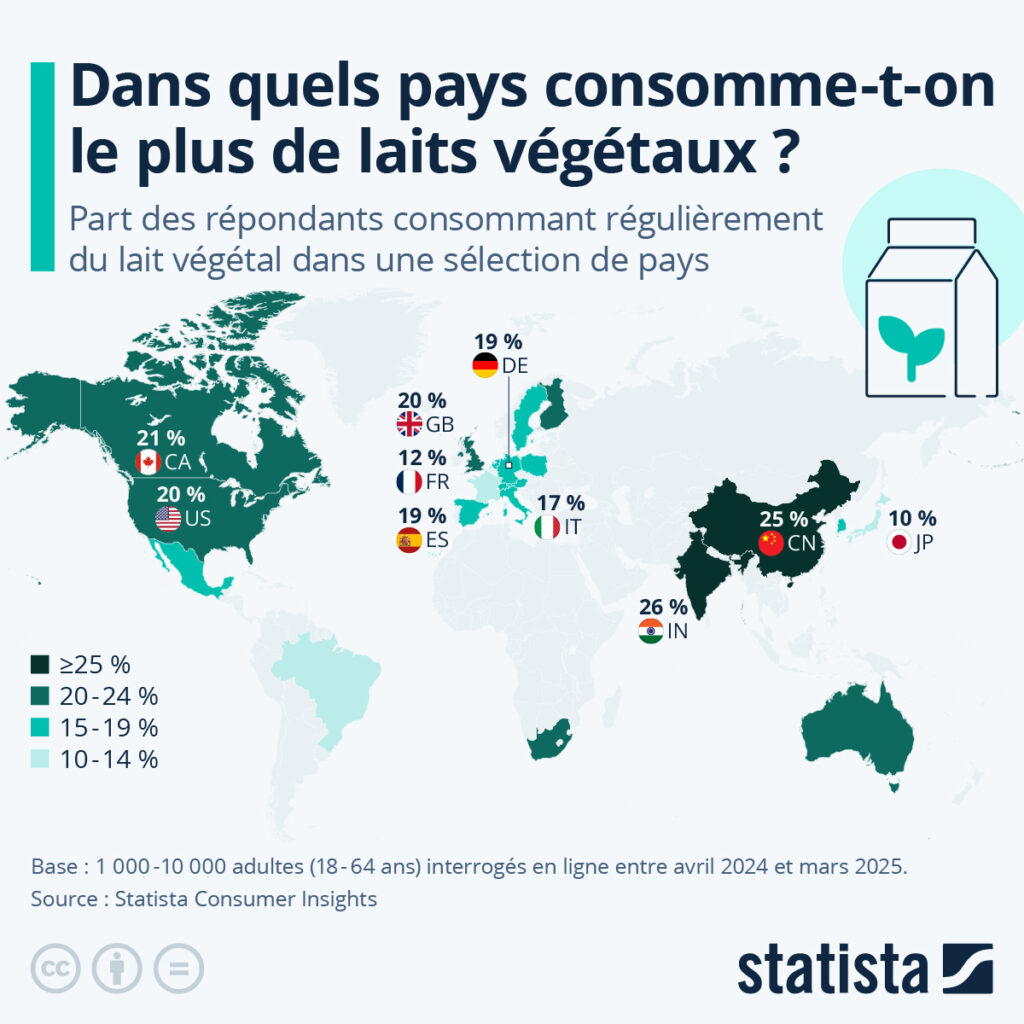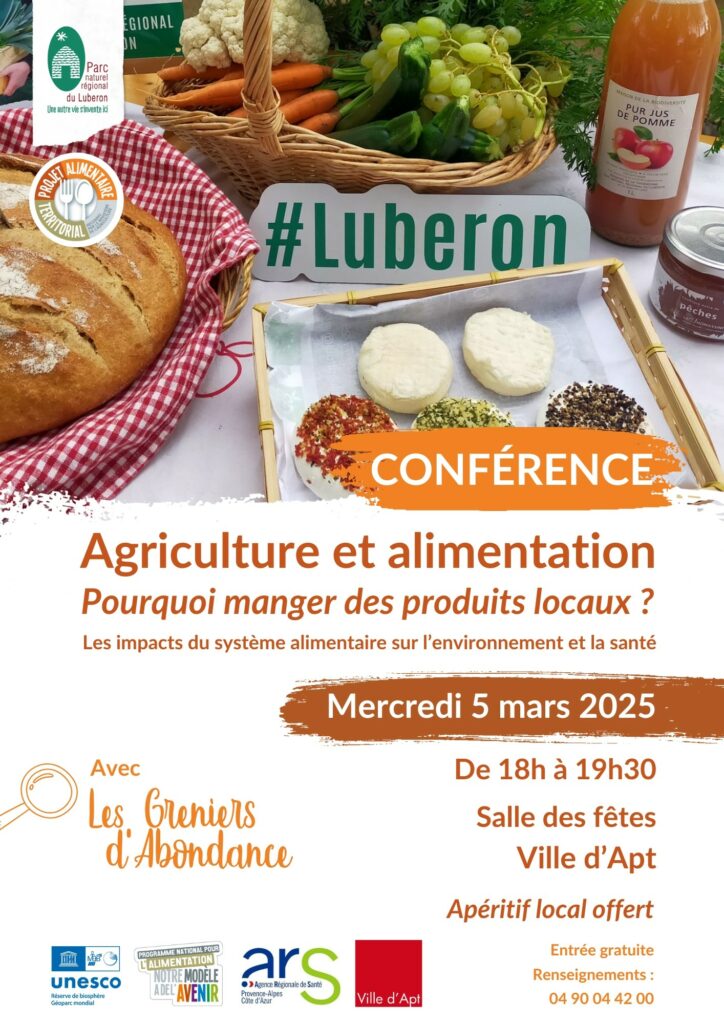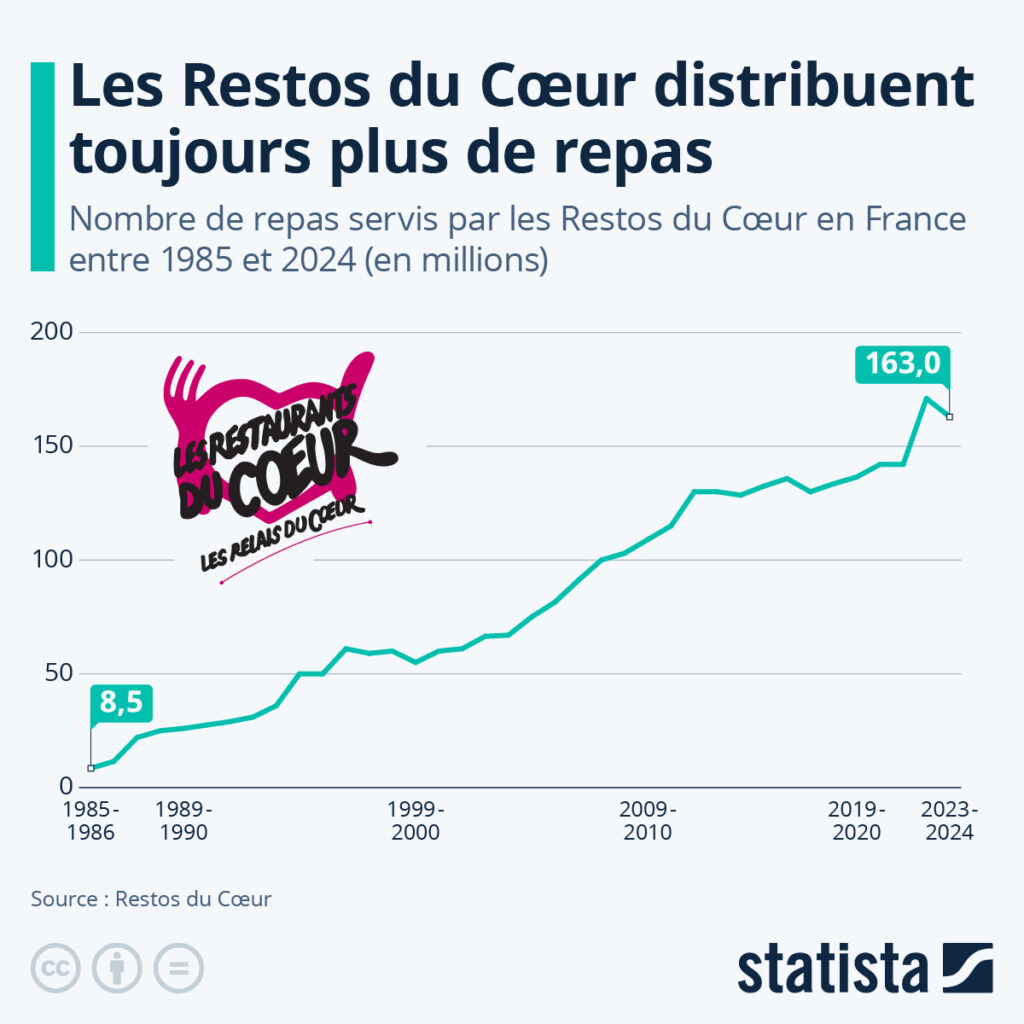Les Apiculteurs en Provence se sont engagés dans une démarche de certification IGP (Indication géographique protégée) Miel de Provence, un signe de qualité reconnu dans toute l’Union Européenne. Objectif : protéger au mieux protège l’origine et la typicité aromatique de leurs miels tout en garantissant un produit de qualité.
Dans un contexte où la qualité, l’origine et la transparence sont devenues des critères essentiels pour les consommateurs, ces Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), comme les IGP ou le Label rouge, sont autant une garantie pour les consommateurs qu’une opportunité pour les apiculteurs.
Après 10 ans de démarche, la certification IGP est reconnue à l’échelle européenne depuis 2005. Pour la filière apicole provençale, cela veut dire que l’IGP (Indication Géographique Protégée) distingue le miel de Provence en garantissant des caractéristiques spécifiques directement liées à son origine géographique. En effet, les producteurs de miel sous IGP produisent du miel de Provence exclusivement dans la Région Sud–Paca, ainsi que dans l’ouest du Gard et le sud de la Drôme.
Pour rappel, le Label Rouge pour le miel de Lavande a été acté en France 1989 et celui du miel Toutes Fleurs de Provence a quant à lui été obtenu en 1994.
Un bonus économique et une protection juridique
Une certification loin d’être neutre pour les 300 apiculteurs adhérents aux signes de qualité Miel de Provence et Label Rouge Lavande et toutes fleurs de Provence (dont 57 en Vaucluse). En effet, ces différents labels offrent une valorisation économique pour les producteurs qui leur permet d’être payés à leur juste valeur. En 2020, le miel de Provence IGP se vendait en vrac à un prix moyen de 7,47€/kg, contre 4,60 à 4,80€/kg pour des miels toutes fleurs classiques non certifiés.
Ces dénominations de qualité permettent également une protection juridique face à la concurrence déloyale et aux fraudes, telles que l’usage abusif de noms valorisants par des produits importés ou fabriqués hors zone. Cette protection s’applique tout aussi bien aux producteurs qu’aux consommateurs qui peuvent acheter sereinement ces miels produits par les abeilles locales.

Renforcement de la filière et cahier des charges commun
Autre avantage « les SIQO renforcent ainsi la structuration des filières agricoles, expliquent les Apiculteurs en Provence. En s’appuyant sur un cahier des charges commun, ils fédèrent les producteurs autour d’une démarche collective de qualité. Ils contribuent également à mieux faire connaître le métier d’apiculteur et à promouvoir les productions locales.
Par ailleurs « l’origine provençale du miel est assurée par une traçabilité contrôlée, renforcée par des analyses polliniques et organoleptiques qui permettent de certifier l’authenticité du produit, poursuivent les représentants de la filière*. Le Label Rouge, de son côté, distingue des produits de qualité supérieure, sur la base de critères rigoureux, notamment physico-chimiques et organoleptiques. C’est le cas du miel de lavande et du miel toutes fleurs Label Rouge, qui doivent répondre à un cahier des charges précis et dont les opérateurs font l’objet de contrôles réguliers. En Provence, le Label Rouge est systématiquement associé à l’IGP : la qualité et l’origine géographique sont ainsi conjointement garanties. »
La production régionale en miel avoisine les 2 500 tonnes par an (dont 60% de la distribution est assuré en vente directe). Parmi cette production, on retrouve celle de apiculteurs vauclusiens qui représente, hors volumes des coopératives, 16 087kg en IGP, 24 737kg en Label Rouge lavande et 3 571kg en Label Rouge toutes fleurs. L’apiculture provençale est la première filière apicole de France en termes de signes de qualité.
*Apiculteurs en Provence regroupe notamment l’Association pour le Développement de l’Apiculture Provençale (ADAPI), le Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud et la Coopérative Provence Miel. L’ensemble représente les 3 600 apiculteurs provençaux qui exploitent près de 163 000 ruches dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.