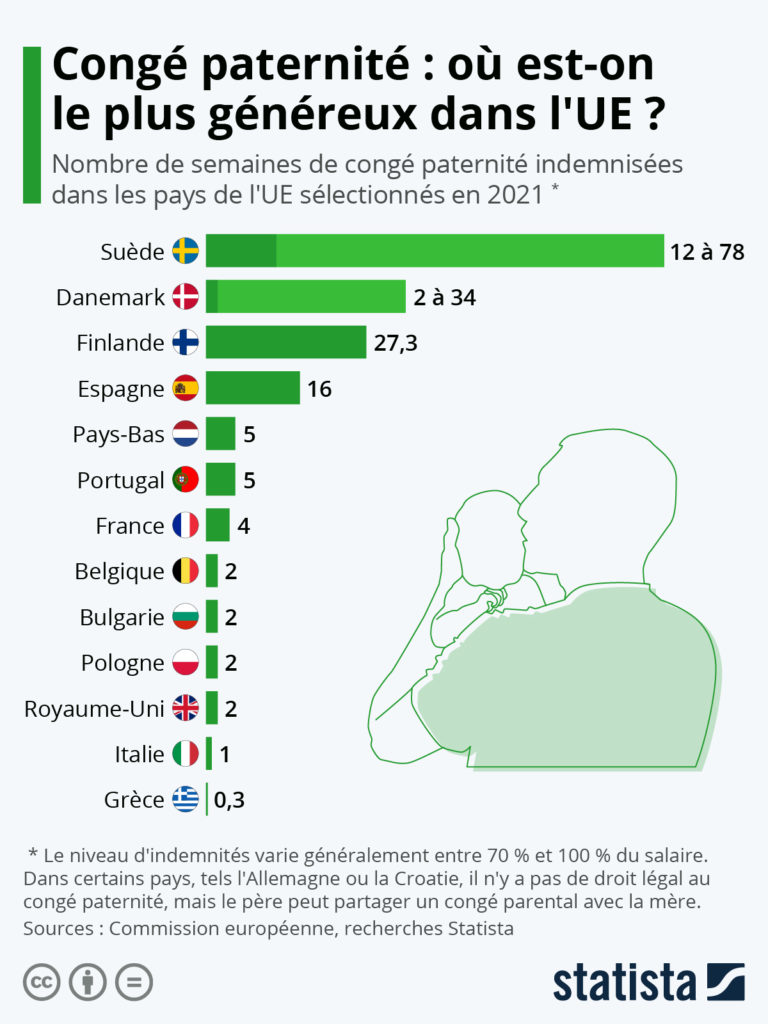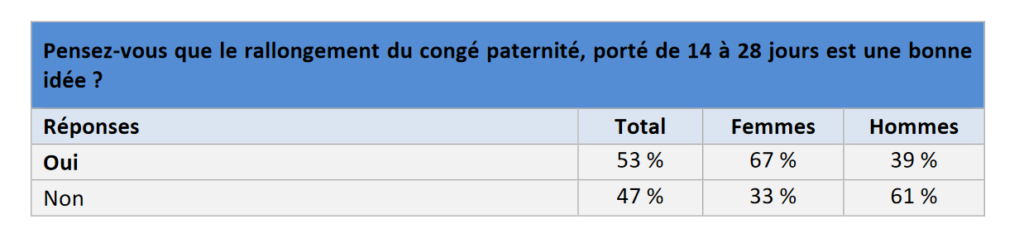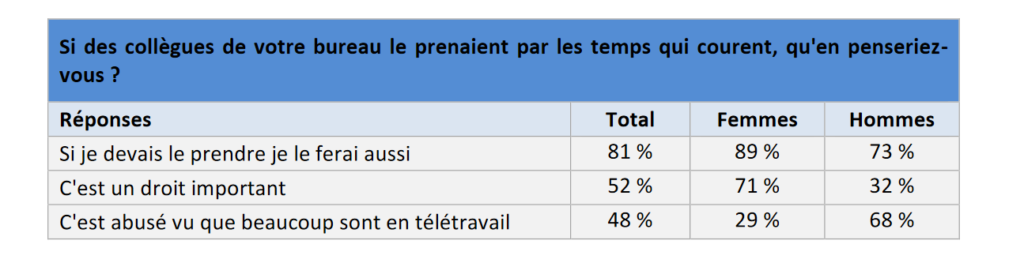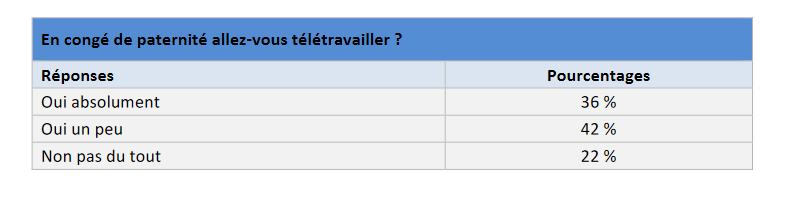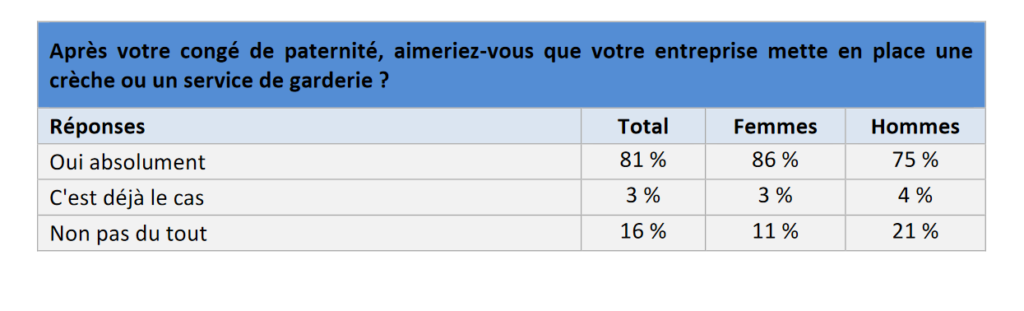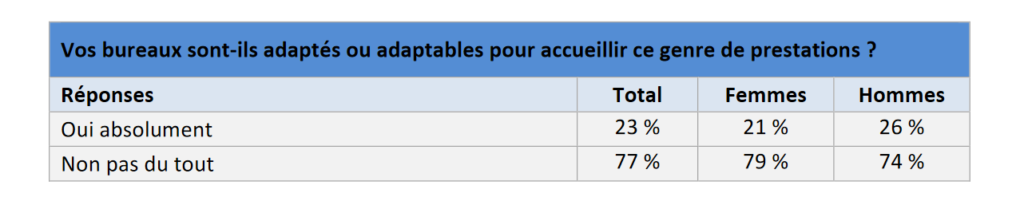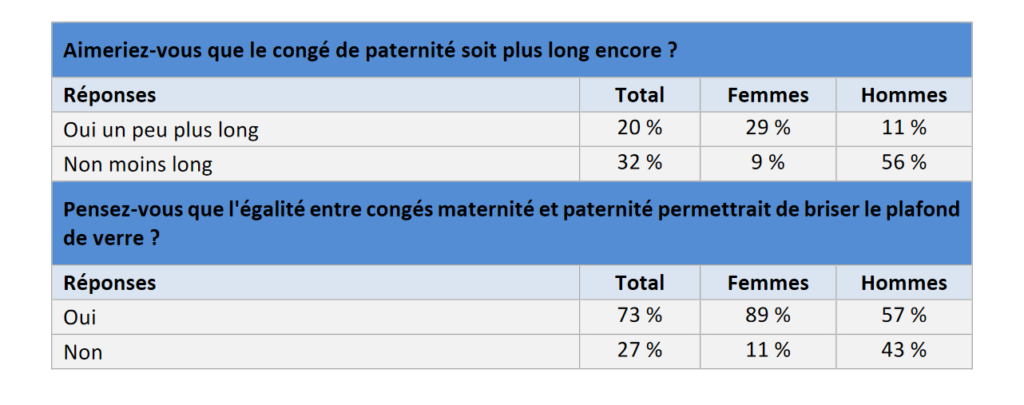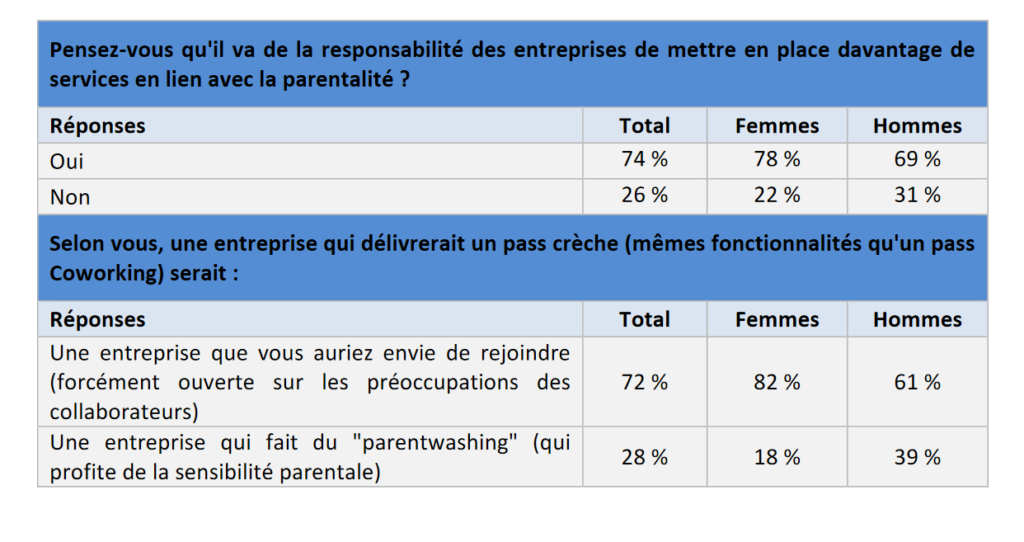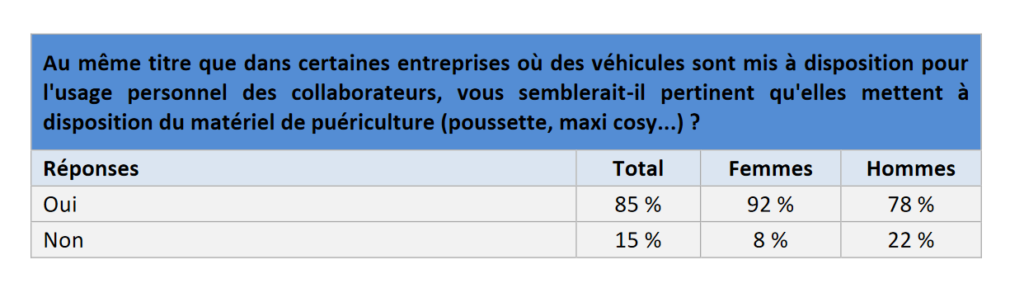Annonce de la réouverture des boîtes de nuits, levée du couvre-feu, réouverture des restaurants, des commerces et lieux recevant du public, lancement des premiers festivals et autres activités culturelles et plus globalement la levée des principales contraintes sanitaires, la vie économique reprend rapidement. Pour les huissiers de justice, si l’heure est désormais à la reprise, elle l’est d’autant plus au soutien des entreprises, très fragilisées par cette longue crise sanitaire. Mobilisés sur tout le territoire national, ils les accompagnent pour une reprise sereine et sûre, grâce à leurs solutions de constats Legalpreuve. Des constats à forte valeur ajoutée, délivrés par officier public et ministériel, permettant aux entreprises de se prémunir contre tout risque d’entrave à la bonne reprise de leur activité. Auxiliaires de justice et juristes de proximité, les huissiers de justice interviennent également pour aider les entreprises à préserver leur trésorerie en proposant des solutions de résolution amiable.
Réouverture en toute sécurité grâce au constat de reprise d’activité Legalpreuve
Lancé en mai dernier au premier déconfinement, le constat Legalpreuve reprise d’activité atteste du bon respect des règles sanitaires dans les locaux. Contraintes au respect de nombreux dispositifs sanitaires qui évoluent rapidement, les entreprises, en s’appuyant sur l’accompagnement et les conseils d’un huissier de justice, s’assurent ainsi d’une réouverture sereine et pérenne.
Lorsque le constat est réalisé, l’entreprise peut afficher une signature visuelle (Règles sanitaires covid 19 constatées par huissier de justice) en interne ou sur son lieu de vente pour rassurer le public présent et l’autoriser à consulter l’intégralité du PV. Il contribue à la réassurance des salariés et des clients mais aussi du chef d’entreprise qui s’adosse à une preuve délivrée par un officier public et ministériel afin de se prémunir des différents contentieux.
Discothèques, festivals, terrasses, vie nocturne et activités de plein air : se prémunir des risques grâce au constat Legalpreuve d’apaisement sonore
Le constat Legalpreuve d’apaisement sonore permet aux entreprises de faire vérifier et valider la puissance sonore émanant de leurs activités et de se parer contre toute attaque ou risque de fermeture administrative qui pourrait émaner de plaintes de riverains. Tout comme le constat reprise d’activité, ce constat, matérialisant une preuve par officier public et ministériel, répond à des règles et une méthodologie précises, qualifiant le bruit selon des critères objectifs de durée, fréquence, intensité, répétition, émergence, nature… et d’après un référentiel élaboré en collaboration avec le Cidb. Le constat pour les entreprises
est établi en fonction des règles générales et locales sur le bruit. Les entreprises qui dressent un constat Legalpreuve d’apaisement sonore attestent ainsi de leur intention de respecter les règles de conformité sonore. Destiné au professionnel souhaitant prévenir tout conflit avec son voisinage du fait de sa propre activité (diurne ou nocturne), le constat Legalpreuve peut être consultable par des tiers et une signature visuelle être affichée dans les locaux.
Désamorcer les conflits par la mise en conformité et la preuve
Des constats Legalpreuve accessibles via une plateforme dédiée : simple et rapide d’utilisation, elle délivre déjà un certain nombre de conseils et permet de trouver l’huissier de justice le plus proche. L’huissier de justice retenu accompagne alors l’entreprise dans toute la démarche, du conseil à la mise en place de solutions concrètes à la délivrance du constat et de sa signature à apposer dans l’établissement comme preuve de bonne conformité.
Ces constats à forte valeur ajoutée mettent en relief le rôle d’accompagnement juridique et de conseil de l’huissier de justice qui fait partie intégrante de ses obligations déontologiques au service des entreprises. Dans cette optique, l’huissier de justice suivra, pour la réalisation de ce constat, un protocole transmis par son Ordre national afin qu’il puisse vérifier qu’il a dûment rempli toutes ses obligations vis-à-vis de son client.
Résolution amiable des impayés
Le montant total du passage en pertes pour créances impayées ne cesse d’augmenter en France : il se monte actuellement à 56 milliards d’euros (source : Figec). Dans une situation d’impayé, près de neuf entreprises sur dix et plus de huit particuliers débiteurs sur dix sont en réalité solvables. A l’heure actuelle, un quart des dépôts de bilans qui sont observés sont imputables directement à un défaut de paiement, et ce sans compter sur les nombreux conflits interentreprises qui en découlent. Les effets de la pandémie sur la trésorerie des entreprises sont appelés à se prolonger.
Plus particulièrement dans la période ‘post-covid’ il sera impératif de mettre en place des stratégies de résolution amiable des impayés qui ne mettent pas en danger l’équilibre financier du débiteur ou les relations professionnelles entre les créanciers et les débiteurs. Dans un tel contexte, l’action des officiers publics et ministériels, et tout particulièrement des commissaires de justice / huissiers de justice, pourrait se révéler essentielle. Au-delà de ses actions de recouvrement forcé, les huissiers de justice, implantés sur les territoires ruraux et urbains, sont en capacité d’intervenir en matière de résolution amiable pour les entreprises.
Titre exécutoire et médiation obligatoire
Pour les créances inférieures à 5000 €, les huissiers de justice peuvent également proposer un paiement de la dette à l’amiable mais en délivrant un titre exécutoire. C’est ce qu’on appelle la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, créée récemment par la loi Croissance et activité du 6 août 2015.
Enfin, pour les créances de – de 5000 €, une tentative de médiation est obligatoire avant la saisine du juge. La profession des huissiers de justice a mis en place des offres spécifiques pour assurer cette tentative.