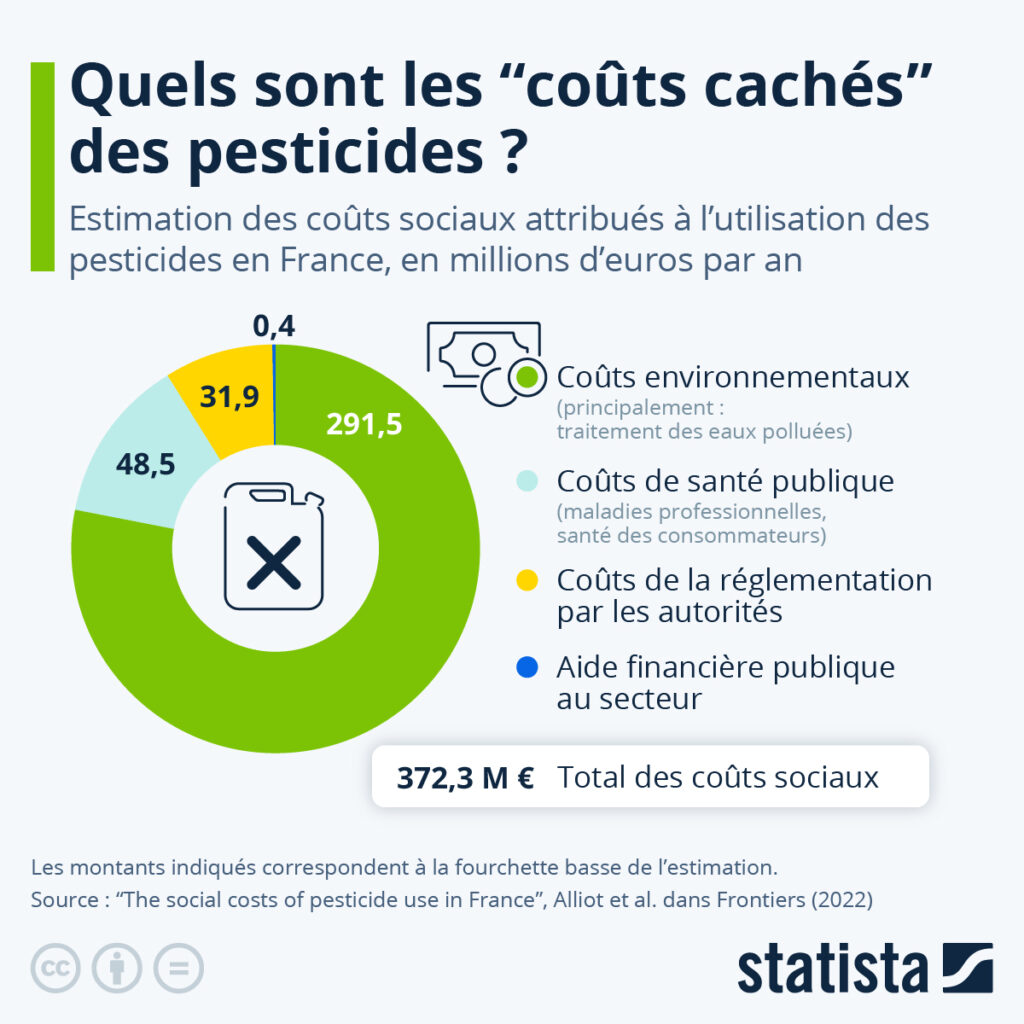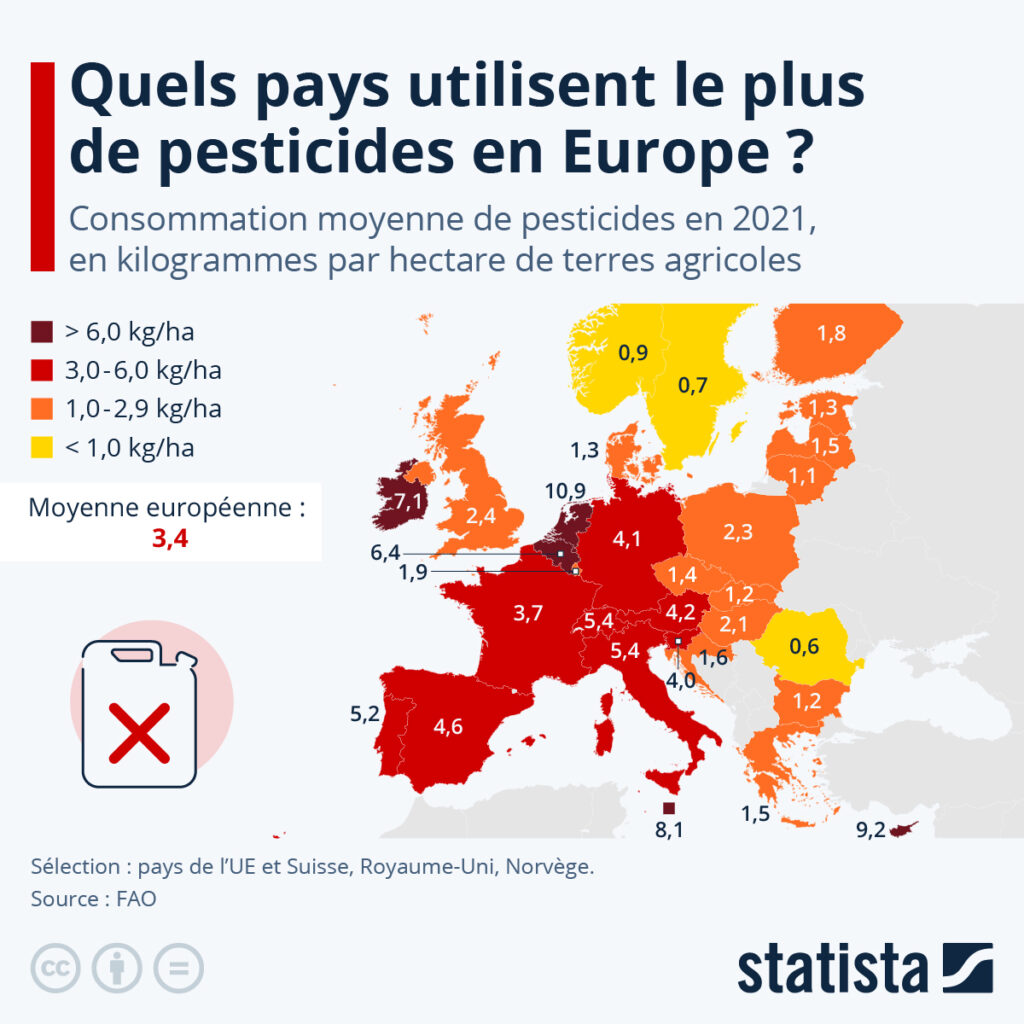Les résultats de l’étude nationale sur l’exposition aux pesticides des riverains en zones viticoles, appelée ‘PestiRiv’, ont été publiés ce lundi 15 septembre. La filière viticole défend être déjà mobilisée dans la réduction de l’usage des pesticides mais se dit aussi du côté de la science et prête à entendre ce que dévoileront de prochaines études.
Lancée en octobre 2021 par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) et par Santé Publique France, l’étude PestiRiv vise à mieux connaitre l’exposition aux pesticides des personnes vivant près de vignes. Le but était de mesurer l’exposition aux pesticides, et non d’en évaluer les effets sur la santé.
Cette étude avait pour objectif de répondre à quatre questions :
- Les personnes vivant à proximité des vignes sont-elles plus exposées aux pesticides que celles vivant dans des zones éloignées de toute culture ?
- Quels sont les facteurs qui influencent cette exposition (par exemple : distance aux vignes, comportements du quotidien) ?
- Comment cette exposition évolue-t-elle selon les périodes de l’année (comparaison entre période de traitements phytosanitaires et période sans traitement) ?
- Quels sont les liens entre les différents niveaux de contamination des milieux et les niveaux d’imprégnations des personnes ?
Les résultats de l’étude
2 700 personnes, âgées de 3 à 79 ans, réparties dans six régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur), ont participé aux deux périodes de l’étude : pendant les traitements et hors traitement des vignes.
Ainsi, les analyses ont révélé que l’exposition aux pesticides était effectivement plus élevée en zones viticoles, et plus forte pendant la période de traitement. « Même si PestiRiv ne livre pas d’enseignements spécifiques sur les risques (sanitaires et sur la santé) associés aux expositions observées, l’influence de la proximité des cultures sur la contamination des milieux et l’imprégnation des personnes montrée par ses résultats incite à agir pour limiter l’exposition des riverains », indique l’étude.
Les viticulteurs se placent du côté de la science
Face aux résultats de PestiRiv, la filière viticole tient à rappeler qu’elle attendait avec intérêt ces résultats. « Le sujet de l’utilisation des pesticides s’inscrit dans un débat de société qui nous concerne tous : pouvoirs publics, chercheurs, viticulteurs, parties prenantes et citoyens », déclare Bernard Farges, Président du Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV).
Les viticulteurs affirment qu’ils limitent l’usage des pesticides quand ils le peuvent et ont déjà fait de gros progrès concernant leurs pratiques, mais que les progrès se feront en collaboration avec les fabricants de pesticides qui doivent trouver des solutions alternatives. « L’État a aussi un rôle à jouer en améliorant dès à présent les procédures d’homologation de substances, en particulier celles de biocontrôle », ajoute le président du CNIV.
« Depuis dix ans, la dynamique est là : la France s’impose parmi les tout premiers vignobles bio au monde avec plus de 20 % des surfaces désormais conduites en agriculture biologique et 88% des surfaces viticoles sont engagées dans une certification environnementale », insiste-t-il. Malgré les progrès, la filière viticole se dit du côté de la science et attend des études plus poussées qui indiqueront plus finement si ces niveaux d’exposition présentent ou non des risques sanitaires potentiels.
Pour en savoir plus sur l’étude PestiRiv, cliquez ici.