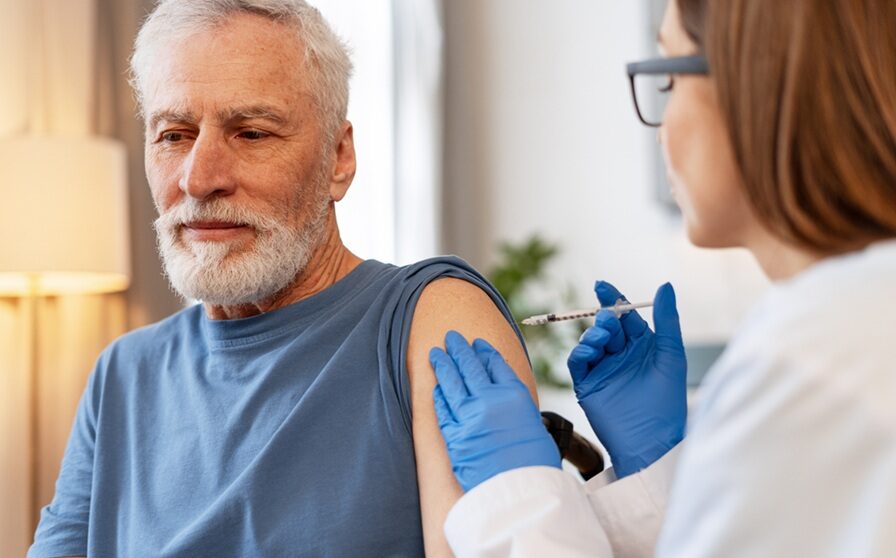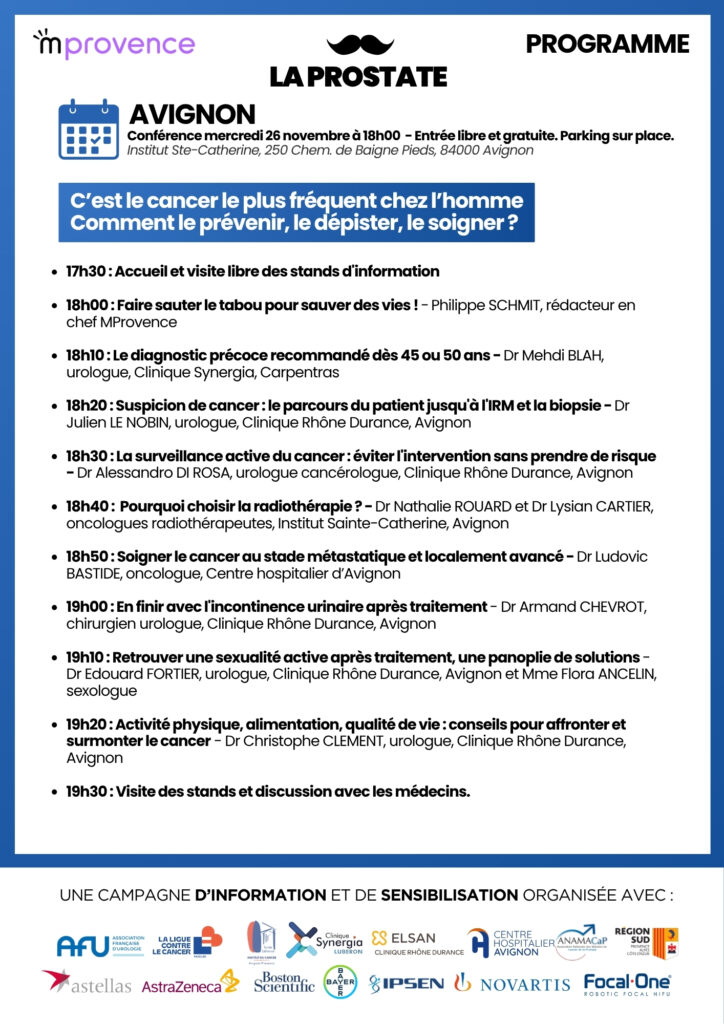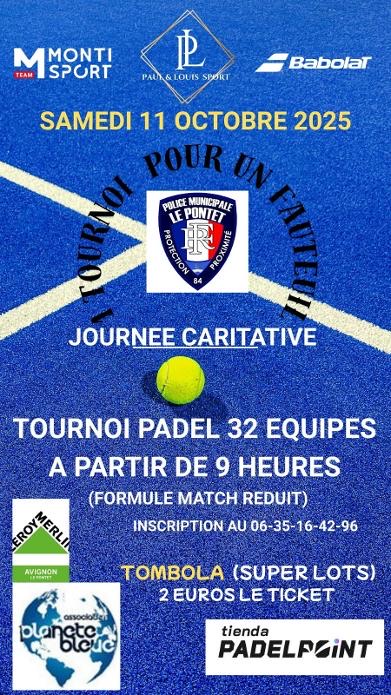Les maladies d’hiver sont déjà de retour en France. L’occasion pour la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en Vaucluse de faire un point sur la vaccination dans le département.
Comme chaque année à l’approche de l’hiver, avec l’arrivée des pathologies respiratoires et rhino pharyngées telles que la grippe ou encore la bronchiolite, l’ARS lance sa campagne de vaccination.
L’occasion pour Loïc Souriau et Nadra Benayache, directeur et directrice adjointe de la délégation départementale de l’ARS en Vaucluse, d’évoquer les risques de la non-vaccination et les bons gestes à adopter.
Une couverture vaccinale insuffisante en Vaucluse
« Même si on a l’habitude des pathologies hivernales qui reviennent chaque année, ce sont des maladies qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé et qui peuvent créer des tensions au niveau du corps médical », affirme Loïc Souriau.
« La couverture vaccinale en Vaucluse est en dessous du niveau national. »
Loïc Souriau
En 2024, moins de 49% des personnes éligibles à la prise en charge totale de la vaccination par l’assurance maladie, à savoir les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques et le personnel de santé, ont bénéficié de la vaccination.
L’espoir d’une relance de la vaccination
Pour les personnes non éligibles à la prise en charge totale de la vaccination par l’assurance maladie, il est aussi possible de se faire vacciner pour une vingtaine d’euros (comprenant le coût du vaccin et celui de l’action vaccinale). L’ARS espère une relance de la vaccination en Vaucluse.
« 65% de la population vaccinée permettrait d’éviter la prolifération de la grippe. »
Loïc Souriau
L’ARS souligne tout de même une bonne couverture vaccinale chez les plus de 80 ans (80%). « Le vaccin n’est pas une solution miracle, mais protège tout de même d’une forme grave de la grippe qui peut entraîner une hospitalisation, voire un décès », rappelle le directeur de la délégation départementale. L’année dernière, les conséquences graves de la grippe ont particulièrement touché les moins de 5 ans et les plus de 65 ans.
Et le Covid-19 ?
Le Covid-19, quant à lui, est toujours présent. « On en a parlé début septembre au moment de la rentrée et on en reparlera sûrement pendant les vacances de fin d’années qui sont propices aux rassemblements familiaux intergénérationnels », ajoute Loïc Souriau. Les hôpitaux du territoire anticipent donc les tensions qui vont potentiellement subvenir à la fin de l’année avec l’ouverture de lits saisonniers, notamment à Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon.
Désormais, le vaccin, que ce soit pour le Covid-19 ou la grippe, est plus accessible puisqu’il peut être prescrit et administré par les pharmaciens (avec ou sans rendez-vous selon les pharmacies), infirmiers libéraux, médecins traitants, professionnels des établissements de santé et dans les EHPAD, ainsi que les sages-femmes.
Vers une meilleure couverture vaccinale ?
Chaque année, la délégation départementale de l’ARS en Vaucluse se questionne sur les solutions à apporter pour obtenir une meilleure couverture vaccinale sur le territoire. « Il faut lancer la campagne plus tôt sans trop anticiper car on risquerait de ne pas couvrir tout l’hiver », explique Nadra Benayache. L’année 2024 en est l’exemple parfait puisque l’épidémie a été forte et longue car elle est apparue tôt.
Ainsi, l’ARS axe sa communication sur la vaccination, mais aussi et sur les mesures de protection individuelle, à savoir le port du masque lorsqu’on a des symptômes, le lavage de mains fréquents mais aussi la distanciation sociale, notamment lors de rassemblements familiaux où il y a un risque accru de contaminations croisées.
La bronchiolite chez les jeunes enfants
Autre maladie hivernale qui inquiète : la bronchiolite. Les jeunes enfants de moins de deux ans sont les plus concernés par le virus respiratoire syncytial (VRS), qui entraine une atteinte pulmonaire et qui peut mener au décès de l’enfant. Il se transmet souvent au sein de la fratrie, dans les crèches et dans les écoles.
Depuis 3 ans, il existe un traitement prophylactique qui contient des anticorps pour aider l’enfant à réagir rapidement en cas d’infection. Lorsque l’enfant naît, le traitement est proposé immédiatement aux parents. Chaque année, plus de 90% des enfants nés en Vaucluse prennent ce traitement dès la naissance. « C’est un vrai succès de santé publique », conclut Loïc Souriau.